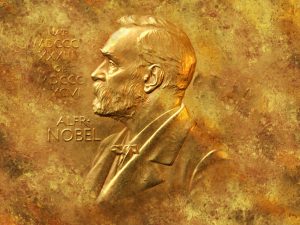Déc 28, 2017 | Justice internationale, Passage au crible, Théories des relations internationales
Par Jean-Jacques Roche
Passage au crible n° 170

Source: FlickR
Onze ans après la mort en détention de Slobodan Milosevic, le Tribunal Pénal pour l’ex-Yougoslavie a, le 22 novembre 2017, condamné à perpétuité le général serbo-bosniaque Ratko Mladic pour génocide et crime contre l’humanité. Une semaine plus tard, à l’énoncé de sa condamnation à vingt ans de réclusion, le croate Slobodan Praljak s’est suicidé en pleine audience du TPIY. Ces deux événements invitent à reconsidérer la raison d’État au regard de la protection des droits de l’homme et des progrès accomplis ces dernières années par la justice transitionnelle. En effet, cette justice de transition constituée d’un ensemble de mesures judiciaires et non judiciaires a pour objet de réparer les dommages causés par la violation des droits humains commise dans les sociétés qui ont enduré un conflit armé ou bien un régime autoritaire.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
L’un des initiateurs des premières conférences internationales consacrées au droit humanitaire, Frédéric Fromhold de Martens estimait au début du XXe siècle que le progrès à l’œuvre dans l’histoire se manifestait à travers « le degré de considération accordée à l’être humain en tant que tel [ce qui] indique toujours pour une époque considérée le niveau de développement des relations internationales et du droit international ». Si ce siècle a connu de grandes catastrophes humanitaires, il a également vu se poursuivre des évolutions au cours desquelles la violence a sensiblement reculé, tout en assurant une meilleure reconnaissance de l’égale dignité de tous les hommes. Il semblerait donc avoir confirmé « la loi tendancielle à la réduction de la force employée » mise à jour par Raymond Aron en 1962.
Cadrage théorique
La question de la justice transitionnelle reste le plus souvent abordée sous l’angle de la technique juridique afin de mieux en rappeler les limites. En cas de carence, elle s’avère par définition complémentaire de celle de l’État et se trouve le plus souvent assimilée à celle des vainqueurs. Tentons par conséquent d’éclairer ces débats par une mise en perspective théorique.
Faut-il, avec René Girard, achever Clausewitz ? Autrement dit, peut-on continuer à considérer que la guerre reste toujours « la poursuite de la politique par d’autres moyens », tant la condamnation du recours à la force s’est généralisée, du moins dans les relations interétatiques ? Faut-il dès lors cestimer à l’encontre de Raymond Aron que la spécificité des relations interétatiques ne réside plus dans « la légitimité et la légalité du recours à la force » ? Faut-il, en complément à l’analyse du général Beaufre, affirmer que le vingtième siècle a connu deux ruptures stratégiques majeures, la première avec la découverte du nucléaire et la seconde avec la reconnaissance des droits inhérents à la personne humaine ?
Analyse
Les relations établies entre les entités étatiques font référence à trois concepts : le système international, la société internationale et la communauté internationale. Précisons d’emblée qu’il ne s’agit pas de la société-monde de Charles Manning et de John Burton ou de la société des individus de Norbert Elias qui intègrent toutes les deux d’autres acteurs que les seuls États. Rappelons qu’avant même l’avènement du monde westphalien, les unités politiques ont entretenu des relations constantes, tant sur le plan politique que sur le plan économique ou culturel. Dès le XVe siècle, ce réseau d’échanges est devenu suffisamment dense pour qu’il soit possible d’évoquer l’existence d’un système international.
S’agissant de la société internationale, elle correspond à une phase d’institutionnalisation. Contrairement au système international, elle ne se limite pas à un simple agencement mécanique d’unités politiques, interagissant les unes par rapport aux autres. Elle exige en effet que deux conditions soient remplies : un niveau d’interactions suffisamment élevé pour associer durablement les parties et la prise de conscience d’instaurer nécessairement un ordre international. Pour Hedley Bull, elle se présente comme « un groupe de communautés politiques indépendantes [… qui ont] établi par voie de dialogue et de consentement un ensemble de règles communes et d’institutions pour la conduite de leurs relations et qui reconnaissent leur intérêt mutuel à maintenir ces arrangements ». Cette société internationale représente, chez Bull, une construction politique consciente et autorégulée. Elle se fonde sur un contrat écrit, lequel jette les bases du droit des gens, le droit international public qui apparaît en 1625 avec l’ouvrage De Jure Belli ac Pacis de Grotius. Enfin, lors de l’ultime étape, se forme – contrairement à l’ordre interne où la Gemeinschaft précède la Gesellschaft – une communauté internationale. Cette dernière correspond à un groupement d’acteurs étatiques qui partagent des valeurs identiques, lesquelles permettent l’identification du groupe et lui servent de ciment. Cette entité repose sur la découverte d’un nombre restreint de valeurs communes (les valeurs des « nations civilisées » de l’article 38 du statut de la CIJ (Cour Internationale de Justice), auxquelles la majorité des acteurs étatiques accepte de se soumettre, sans même qu’il soit nécessaire de faire référence à un texte écrit. Cette communauté internationale dépasse donc la société internationale sous trois aspects : elle détient des responsabilités particulières, elle crée des normes qui s’imposent aux États, y compris en dehors de leur consentement. Enfin, elle dispose de la capacité de sanctionner les acteurs qui manqueraient à ce corpus normatif non écrit, fondement d’un ordre public international en devenir.
Promue aujourd’hui par les Nations unies, la justice transitionnelle et ses avancées civilisationnelles semblent donc désormais porter témoignage de l’émergence d’une communauté internationale au sens où l’entendait le théoricien réaliste Hedley Bull.
Références
Sur la justice transitionnelle
Turgis Noemie, La Justice Transitionnelle en Droit International, Bruxelles, Bruylant, 2014.
Aersten Ivo, Arsovska Jana (Eds.), Restoring Justice after Large Scale Violent Conflicts – Kosovo, DR Congo, the Israeli-Palestinian Case, Routledge, 2012
Sur le système international
Brecher Michael, « Système et Crises en Politique Internationale », Etudes Internationales, 14 (4), 1984, pp. 755-788
Waltz Kenneth, Theory of International Politics, Reading, Addison Wesley, 1979.
Sur la société internationale
Bull Hedley, The Anarchical Society – A Study of Order in World Politics, London, Macmillan, 1977
Bull Hedley & Watson Adam (ed), The Expansion of International Society, Oxford, Clarendon Press, 1984.
Laroche Josepha, Théorie des conflits internationaux. Les réalistes, 2e éd., Paris, L’Harmattan, 2016,
Sur la communauté internationale
Roche Jean-Jacques, Relations Internationales, Paris, Lextenso-éditions, 7° éd., chapitre 2.
Villalpando Santiago, L’Emergence de la Communauté Internationale dans la Responsabilité des États, Genève, Graduate Institute Publications, 2005.
Déc 24, 2017 | Diplomatie, Passage au crible, Réchauffement climatique
Par Lea Sharkey
Passage au crible n° 169

Source: Pixabay
À la fois technique et politique, la COP23 (Conférence des Parties), qui s’est tenue à Bonn du 6 au 17 novembre 2017, était dédiée aux premières négociations sur les applications de l’Accord de Paris sur le climat. Or, le 1er juin 2017, Donald Trump a annoncé sa décision de retirer les États-Unis de ce traité historique.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Entré en vigueur le 4 novembre 2016, le traité de Paris engage ses signataires à maintenir le réchauffement planétaire dû aux activités humaines « nettement en deçà » de 2°C d’ici à 2100 (par rapport à la température de l’ère préindustrielle). À Marrakech, lors de la COP22, les parties se sont donné pour objectif de mettre en œuvre les règlements adoptés – « the Paris Ru-lebook » – d’ici fin 2018. Les États parties sont donc invités à traduire leurs engagements de 2015 en programmes énergétiques et économiques nationaux. Ils doivent en outre forger les outils destinés à assurer la concrétisation de leurs plans.
En marge de la COP23, le bilan mondial du Global Carbon Project publié le lundi 13 novembre indique une nouvelle augmentation des rejets globaux de dioxyde de carbone. Cette situation est due à l’embellie de la croissance chinoise (+6,7%) qui fait de la RPC (République Populaire de Chine), le premier émetteur de CO2 depuis 2007. Le Climatescope, le rapport d’évaluation des investissements par pays publié en novembre 2017 par Bloomberg New Energy Finance, note par ailleurs que seuls quatorze des soixante-et-onze États étudiés, ont su élaborer des stratégies concrètes de réduction de leurs émissions.
Au cœur de ces engagements se trouve le financement de 100 milliards de dollars qui doit être consacré aux pays en développement. Sur ce point, le retrait annoncé par Donald Trump représente tout à la fois un revers politique et économique. En effet, Washington ne versera plus de contribution à la CNUCC (convention cadre des Nations unies sur le changement climatique), ni au GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Enfin, ce désengagement américain affaiblit une dynamique mondiale et un consensus qui avaient été déjà difficiles à obtenir en 2015. Rappelons que le texte adopté lors de la COP21 retenait le principe de contributions volontaires non assorties de sanctions, engageant au total cent-quatre-vingt-quinze pays. Bien que les déclarations sur « l’irréversibilité de l’Accord de Paris » se soient multipliées – pour reprendre l’expression de Ségolène Royal, ou du Président de la COP22 Salahedine Mezzouar – il est certain que l’absence de leadership américain produit aujourd’hui des effets sur l’implication et le positionnement des autres signataires, notamment la Chine.
S’agissant de ce pays, il adopte habituellement une position pivot durant les négocia-tions climatiques qui le conduit à se tenir à égale distance des pays développés et des pays en développement. Avec un PIB (Produit Intérieur Brut) par habitant inférieur à la moyenne mondiale, Pékin affirme son droit à la croissance économique et se pose ainsi en porte-parole du Groupe des 77. Mais dans le même temps, la RPC souligne qu’avec 10,4 milliards de tonnes de CO2 rejetés par an, le cumul historique de ses émissions ne dépassera pas avant longtemps celui des États-Unis.
Cadrage théorique
1. Le leadership ambigu de la Chine sur la question climatique. Si un axe sino-européen semble bel et bien désormais se dessiner, la politique climatique de la Chine obéit cependant à des impératifs énergétiques et économiques nationaux, ce qui ne laisse pas de révéler des contradictions internes.
2. L’affaiblissement du « consensus de Paris ». S’appuyant sur les engagements librement déterminés des parties, le consensus fragile obtenu en 2015 se retrouve affaibli par le retrait de la première puissance mondiale ; sans compter que les signataires de l’accord de Paris développent des visions divergentes quant à son application concrète.
Analyse
Depuis une décennie, la Chine cherche à s’imposer en leader mondial des énergies renouvelables. Premier investisseur dans le domaine, son objectif vise à combler son retard technologique et à maîtriser sa dépendance envers les ressources provenant de l’étranger. Sous la pres-sion de besoins grandissants, ce pays de près de 1,4 milliard d’habitants requiert un approvisionnement extérieur en charbon, pétrole et gaz. Mais la RPC appréhende désormais la pollution comme un problème de santé publique à l’origine – selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) – de 1,6 million de morts par an. Dans cette logique, elle a adopté en juin 2007 un programme portant sur le climat, arrêté dans le cadre du onzième plan quinquennal, à la suite de la publication du Rapport d’évaluation national sur le changement climatique. Sa capitale se tourne depuis massivement vers les énergies renouvelables et porte un intérêt considérable aux mécanismes de transferts de technologies ainsi qu’aux dispositifs de soutien financier proposés par les pays industrialisés. Pékin élabore une stratégie de coopération internationale fondée sur deux concepts : « go global » et « bringing in » (Alexeeva et Roche, 2014, p.28). Cette politique industrielle vise à accroître l’innovation au sein de ses entreprises énergétiques et à développer leur auto-nomie en termes d’équipements de pointe. L’implication croissante de la puissance chinoise lors des conférences climatiques s’explique par la volonté de maîtriser sa réputation et son image à l’international. Autant d’éléments symboliques qui lui apparaissent indispensables pour nouer des collaborations scientifiques et commerciales avec des partenaires diversifiés. Mais ce volontarisme vertueux coexiste néanmoins avec le maintien d’une forte politique extractive. Autrement dit, la Chine se montre loin de renoncer aux réserves de charbon (les plus importantes de la planète), son mix énergétique restant tributaire à 80% de cette matière première.
En marge des négociations officielles, le Président des États-Unis Donald Trump a claire-ment mis fin à toute politique de réduction des émissions en défendant ouvertement les énergies fossiles. En fait, sa déclaration s’adresse davantage aux États fédérés, villes et entreprises américaines favorables à l’Accord de Paris qu’aux autres signataires du traité. Sa prise de position demeure toutefois fâcheuse dans la mesure où de nombreux pays membres sont eux-mêmes peu enclins à modifier leurs stratégies énergétiques pour qu’elles deviennent plus vertes. Autant dire que l’infléchissement de la politique américaine se répercute sur les modalités d’application du traité ; Washington remettant à présent en cause le fondement même du droit des gens, à savoir la règle pacta sunt servanda. Ceci s’avère d’autant plus préoccupant que la COP23 a achoppé jusqu’à ce jour sur les questions de calcul du prix du carbone et de définition d’un mécanisme de contrôle global qui offrirait des garanties de transparence. À titre d’exemple, si une vingtaine de pays, dont la France et le Canada, se sont engagés à sortir du charbon, il n’en est rien en revanche pour l’Allemagne dont 40% de l’électricité provient encore de ce combustible.
Organisé à Paris, le One Planet Summit du 12 décembre devait précisément répondre à la question de l’accès aux financements privés et publics en faveur d’une économie bas carbone. À cette occasion, la Banque Mondiale et de grands investisseurs privés ont annoncé ne plus vouloir soutenir l’exploration et l’exploitation des ressources polluantes. Ces institutions s’engagent au contraire à privilégier les projets des entreprises vertueuses. Pourtant, l’appui des pays industrialisés reste insuffisant lorsqu’il s’agit de soutenir les initiatives visant une reconversion énergétique. Pour l’heure, il n’atteint pas les 100 milliards prévus dans le traité de 2015.
L’identification d’outils communs se trouve donc reconduite aux prochaines conférences onusiennes, voire sine die. Or, ce travail est ralenti par la multiplicité des échelles, la fin d’un consensus global et les arrangements établis par les parties entre stratégie énergétique, impératif économique et diplomatie climatique. Parallèlement, le secteur privé et les acteurs subnationaux adoptent des engagements thématiques et régionalisés au caractère incrémental. On note donc ainsi que la complexité du problème climatique et énergétique requiert un double mouvement qui articulerait des négociations mettant en interaction États et acteurs transnationaux.
Références
Benberrah Moustafa, « L’entrisme de la Chine dans les sommets internationaux. La diplomatie chinoise au forum de l’APEC, 8-10 novembre 2017 », Chaos international, disponible sur : http://www.chaos-international.org/pac-165-lentrisme-de-chine-sommets-internationaux/
Alexeeva Olga V., Roche Yann, « La Chine en transition énergétique : Un virage vers les énergies renouvelables? », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne], 14 (3), Déc. 2014, consulté le 16 décembre 2017, disponible sur : http://journals.openedition.org/vertigo/15540.
Le Comte Armelle, « One Planet Summit : où en est-on des financements internationaux pour le climat ? », Le Monde, 12 décembre 2017, disponible sur : En savoir plus sur http://ww.lemonde.fr/climat/live/2017/12/12/one-planet-summit-ou-en-est-on-des-financements-internationaux-pour-le-climat_5228341_1652612.html#LDzUyXW3V3jgrxYC.99
Romano Giulia C., « La Chine face au changement climatique : quelle(s) politique(s) ? », Écologie & Politique, (47), 2013, pp. 77-87, Presses de Sciences Po, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2013-2-p-77.htm
Zimmermann Maxime, « La Chine dans le régime climatique : nouveau poids lourd de la scène internationale ? », Eurosorbonne, 28 Août 2017, disponible sur : http://www.eurosorbonne.eu/?p=3733
Déc 23, 2017 | Diplomatie non-étatique, Droit international public, Passage au crible, Terrorisme
Par Moustafa Benberrah
Passage au crible n° 168

Source: Pixabay
Jeudi 7 décembre, Eric Olsen – l’ex-directeur général du cimentier français Lafarge – a été mis sous contrôle judiciaire pour « financement d’une entreprise terroriste et mise en danger de la vie d’autrui ». Le lendemain, L’ex-PDG, Bruno Lafont et son adjoint, Christian Herrault, ont été mis en examen pour les mêmes chefs d’inculpation. L’entreprise est accusée d’avoir financé l’EI (État islamique) pendant un peu plus d’un an, afin de continuer ses activités en Syrie dans la zone de conflits. En outre, elle aurait entretenu des relations commerciales avec l’organisation terroriste, lui achetant notamment des matières premières.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
En 2007, Lafarge acquiert une cimenterie située à Jalabiya, à 150 kilomètres au nord-est d’Alep. Le groupe français alloue alors 680 millions de dollars pendant trois ans afin de rénover ce site. La firme représente à cette époque le plus gros investisseur hors secteur des hydrocarbures en Syrie. Lafarge Cement Syria, LCS est inaugurée en octobre 2010 et commence aussitôt la production. Cependant, en septembre 2011, la guerre civile éclate dans le pays. Le 29 juin 2014, EI (l’organisation État islamique) proclame l’instauration du « califat » et prend le contrôle d’un vaste territoire sur lequel se situe l’usine de Lafarge.
En juin 2016, Le Monde rapporte que le cimentier français a payé des taxes à Daech – Dawlat islamiya fi ‘iraq wa sham, qui signifie État islamique en Irak et au Levant. A cette occasion, le quotidien pointe les conditions de sécurité dans la cimenterie de Jalabiya. Entre 2013 et 2014, Lafarge aurait financé l’organisation terroriste jusqu’à ce que cette dernière s’empare du site le 19 septembre 2014. L’organe de presse met également en cause des arrangements et le recours à des intermédiaires locaux tels que l’actionnaire Firas Tlas, fils de l’ex-ministre de la Défense du président Bachar Al-Assad, ayant permis d’assurer l’accès du personnel à l’usine et la livraison de produits. Le Monde précise que « Lafarge passait par des négociants qui commercialisaient le pétrole raffiné par l’EI, contre le paiement d’une licence et le versement de taxes ». De plus, on reproche au groupe industriel des faits de « financement du terrorisme », de « complicité de crimes de guerre », de «complicité de crimes contre l’humanité » et de « mise en danger d’autrui ». Pour les transactions incriminées, les trois juges d’instruction chargés de ce dossier ont retenu un montant qui s’élève à près de 13 millions d’euros.
En outre, le parquet de Paris a ouvert en octobre 2016 une enquête préliminaire faisant suite à une demande de Bercy. Cette dernière portait sur une potentielle infraction au code des douanes par le groupe Lafarge basé en Syrie. En novembre de la même année, Sherpa, une association française de défense des victimes de crimes économiques a déposé une plainte conjointe avec le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’homme de Berlin contre LafargeHolcim concernant les conditions d’activité dans la même usine. L’organisation humanitaire et deux autres ONG se sont constituées parties civiles dans ce dossier. Elles demandent la mise en examen de la personne morale Lafarge SA et dénoncent une tentative de dissimulation de preuves. Maître Marie Dosé, avocate de Sherpa évoque un refus du groupe de communiquer 9000 documents sur 15 000. Ces pièces ont été utilisées lors d’un rapport d’enquête interne commandé par la firme au cabinet américain Baker & Mckenzie. Or, ce dernier avait confirmé dans son audit l’existence de transactions avec l’organisation terroriste.
Cadrage théorique
1. L’engagement d’un acteur privé dans une économie de guerre. Les entreprises privées s’engageant sur des terrains de conflits satisfont principalement une logique économique. Elles se retrouvent confrontées à une instabilité des normes et des règles qui les conduisent à modifier leur stratégie, ou simplement leurs discours afin de s’adapter en permanence aux aléas de la guerre. De ce fait, elles se livrent souvent à des pratiques contestables en rupture avec les références éthiques qu’elles aiment pourtant afficher.
2. La mise en accusation d’un opérateur économique. Le groupe Lafarge dispose d’un pouvoir hégémonique à la fois structurel et idéologique lui permettant d’infléchir les négociations en fonction de ses intérêts et de sa stratégie globale. Cet intervenant économique occupe alors une position politique à part entière lui permettant d’entrer en compétition avec les pouvoirs publics. Mais d’autres acteurs hors souveraineté, telles que les ONG se mobilisent le cas échéant pour encadrer et dénoncer ses éventuelles transgressions.
Analyse
Dans le cadre de la plainte initiée par Sherpa, qui défend les anciens salariés syriens de Lafarge, l’ONG réclame l’audition par la justice de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères français de mai 2012 à février 2016. Cette demande fait suite à la déclaration des responsables du cimentier ayant reçu l’aval des autorités publiques pour son maintien en Syrie. Selon, l’ancien directeur général adjoint opérationnel du groupe – Christian Herrault – le Quai d’Orsay aurait même recommandé de « tenir ». Ce dernier conteste toutefois cette version des faits et assure que le ministère aurait tout au contraire « alerté le groupe Lafarge sur les risques encourus à rester en Syrie ». De plus, les responsables de l’usine n’avaient pas informé les diplomates des rançons payées à l’État Islamique. Cette mise en accusation transnationale de l’État et de Lafarge par des « entrepreneurs de morale » met l’accent sur le rôle accordé aux valeurs et aux normes dans la définition des intérêts. En l’espèce, plusieurs catégories de professionnels organisés en réseaux ont constitué une coalition souple et dynamique de manière à légitimer plus aisément leurs opérations de dénonciation et de condamnation (show and shame). Comme la démarche de cette communauté épistémique repose sur une connaissance approfondie des faits et des données, elle maîtrise toutes les questions techniques et se montre par conséquent susceptible de mettre en lumière toute violation des règles du droit des gens.
Pour mémoire, rappelons quelques mobilisations antérieures. La dénonciation du travail forcé des détenus emprisonnés par la junte birmane de la part des pétroliers français Total et américain Unocal en 1995 obéissait déjà à cette logique. Citons également la mobilisation civile contre l’embargo mis en place contre l’Irak entre 1991 et 1997 qui a induit de désastreuses conséquences humanitaires. Mentionnons par ailleurs les plaintes collectives déposées auprès de cours américaines contre des institutions financières saoudiennes en raison de leur rôle présumé dans la préparation des attentats du 11 septembre 2001. Enfin, les violentes critiques de plusieurs associations patronales américaines ayant pris position contre l’embargo à l’égard de l’État cubain à partir de 1996 – les firmes américaines étant les premières frappées par ces mesures – qui se sont liées à des Églises protestantes membres du Conseil œcuménique des églises, à des évêques catholiques américains et à des ONG illustrent cette défiance à l’encontre des autorités publiques.
À cet égard, soulignons combien le développement protéiforme du droit dans les relations internationales post-bipolaires a favorisé l’essor de ces campagnes. Nombre d’entre elles reposent par exemple sur des procès qui leur assurent une grande publicité. La CPI (Cour pénale internationale) encourage cette transformation fondée sur une interaction entre le transnational et l’étatique. Le traité de Rome atteste de la prise en compte par les institutions de ces demandes morales. Le premier procureur de cette juridiction, Luis Moreno-Ocampo, avait déclaré dès la création de la CPI qu’elle devait s’intéresser de près aux « activités des multinationales et à leur rôle dans les guerres civiles ».
Ces actions ont ainsi participé d’une transformation systémique de la scène mondiale. Elles ont conduit les nations et les groupes à se prévaloir davantage de la notion de responsabilité. Ainsi, la France a-t-elle adopté en mars 2017 une loi sur le devoir de vigilance des firmes multinationales. En outre, de grandes entreprises telles que Lafarge ont lancé des chartes d’engagements en faveur de l’information et de la communication. Notons qu’après la fusion réalisée entre Lafarge et le groupe suisse Holcim en 2015, la nouvelle entité baptisée LafargeHolcim, devenue le plus grand producteur de ciment, de granulats et de béton au monde, s’est inscrite au registre de transparence des représentants d’intérêts auprès de la Commission européenne. Dès lors, dans le cadre de ses activités de lobbying, elle déclare avoir recruté deux collaborateurs à temps plein et l’allocation d’un budget annuel compris entre 100 000 et 200 000 euros. Cette action se comprend dans le cadre de son adhésion au registre de transparence des représentants d’intérêts auprès de la Commission européenne. Cette initiative représente un argument commercial visant à rassurer les investisseurs et les clients. Notons que ce type d’engagement est pris en considération par certaines agences de notation comme Vigeo qui les intègrent ensuite dans ses expertises. En effet, depuis juillet 2010, ce leader européen en la matière inclut l’intégrité des stratégies et des pratiques de lobbying dans son référentiel de classification destiné à évaluer la responsabilité sociale des entreprises.
En prenant le monde pour scène, les ONG se posent en entrepreneurs de morale et stigmatisent des pratiques qu’elles jugent déviantes au regard du droit international public. Pour ce faire, elles n’hésitent pas à recourir à la technique du shaming, voire à s’organiser sur le mode du scandale. De la sorte, elles réussissent parfois à infléchir les politiques des États aussi bien que la stratégie des firmes transnationales comme nous venons de le voir dans l’incrimination de Lafarge.
Références
Arfi Fabrice, « Financement du terrorisme : les 15 millions de dollars suspects de Lafarge », Mediapart, 12/12/2017, disponible sur :https://www.mediapart.fr/journal/france/121217/financement-du-terrorisme-les-15-millions-de-dollars-suspects-de-lafarge
Benberrah Moustafa, « La conquête chinoise de l’Afrique par l’APD. Le secteur du BTP sous domination chinoise », Chaos international, disponible sur : http://www.chaos-international.org/pac-150-conquete-chinoise-de-lafrique-lapd/
Colonomos Ariel, « Une morale internationale de la mise en accusation », L’Année sociologique, 54 (2), 2004, pp. 565-587.
Harold Garfinkel, « Conditions of Successful Degradation Ceremonies », American Journal of Sociology, 61 (5), 1956, pp. 420-424.
Le Monde, « Comment le cimentier Lafarge a travaillé avec l’Etat islamique en Syrie », Le Monde, 21/06/2017, disponible sur : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/06/21/comment-le-cimentier-lafarge-a-travaille-avec-l-etat-islamique-en-syrie_4955039_3218.html
Ryfman Philippe. Les ONG, Paris, La Découverte, 2014.
Déc 6, 2017 | Biens Publics Mondiaux, Environnement, Passage au crible, Réchauffement climatique

Source: Pixabay
Par Valérie Le Brenne
Passage au crible n° 167
Le 9 novembre 2017, à l’occasion de la visite officielle de Donald Trump à Pékin, le groupe pétrolier Sinopec, le fonds souverain CIC et la Bank of China ont conclu avec une société américaine un contrat d’un montant de 43 milliards de dollars pour développer des infrastructures de GNL (gaz naturel liquéfié) dans le nord de l’Alaska. Pékin, qui entend décarboner son économie, prévoit d’importer 75% des volumes qui y seront produits.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Rappelons tout d’abord que l’Alaska fut une possession russe jusqu’en 1867. Afin de répondre aux difficultés financières de l’Empire, le tsar Alexandre II la céda pour 7,2 millions de dollars aux États-Unis, où cette acquisition fut l’objet de vives critiques. Pour l’opinion publique, cet espace quasi inhabité était en effet dépourvu de tout intérêt. Même le commerce de fourrures, qui s’était développé au cours des années quatre-vingt-dix sous la houlette de la Compagnie russe d’Amérique, connaissait un déclin depuis 1840.
En fait, il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que la région suscite de nouveau des convoitises. Après la découverte d’hydrocarbures dans les sous-sols du Cook Inlet en 1891, les filons aurifères provoquent une véritable ruée vers l’or. Par la suite, le développement de la pêche donne lieu à l’ouverture d’une trentaine de conserveries. Puis, en 1968, est mis au jour le gisement de Prudhoe Bay dont les réserves sont initialement estimées à environ 25 milliards de barils, ce qui en fait l’une des plus importantes réserves d’Amérique du Nord.
Toutefois, l’émergence des préoccupations environnementales et la multiplication des marées noires – en particulier celle, spectaculaire, du Torrey Canyon en 1967 – attisent les con-troverses autour de l’exploitation des ressources naturelles au pôle nord. Les risques induits par les activités extractives nourrissent de nombreuses craintes concernant les dommages irrémé-diables qui pourraient être causés à ces écosystèmes uniques.
En 1996, est adoptée la déclaration d’Ottawa portant création du Conseil de l’Arctique. Composée des huit pays riverains du cercle polaire (Canada, Danemark, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, Islande, Norvège et Suède), cette organisation internationale a pour princi-pal objectif de veiller à la protection de l’environnement et au respect des populations autochtones. Outre ses membres permanents, cette arène compte également des pays observateurs dont la Chine qui a obtenu ce statut en 2013. Régulièrement critiqué pour son manque d’efficacité, ce forum intergouvernemental constitue davantage un outil de coopération permettant d’apaiser les tensions qu’une instance de régulation.
Cadrage théorique
1. L’opportunité du changement climatique. La fonte des glaces consécutive au réchauffement climatique ouvre de nouvelles opportunités en Arctique, en particulier dans le domaine des hydrocarbures. Si cette transformation de l’échiquier énergétique accentue la concurrence pour l’accès aux ressources, elle produit également des partenariats ad hoc entre acteurs publics et privés.
2. L’affirmation du pouvoir structurel de la Chine. Depuis plusieurs années, la Chine manifeste un intérêt croissant pour la région. Faute d’accès direct, elle multiplie les investissements dans les pays frontaliers du cercle polaire. En déployant sa puissance financière, Pékin affirme ainsi son pouvoir structurel.
Analyse
Selon plusieurs estimations, l’Arctique pourrait abriter 90 milliards de barils de pétrole et 30% des réserves mondiales de gaz naturel. Signalons que les pôles sont particulièrement affectés par la hausse globale des températures. En 2016, la fonte de la banquise a atteint un niveau record et les scientifiques ont constaté une réduction inédite des glaces les plus anciennes. Outre l’ouverture de voies navigables, cette transformation a dévoilé de substantielles opportunités en rendant possibles la prospection et l’exploitation de gisements offshore.
Ce faisant, les pays frontaliers recourent à des stratégies variées pour accéder à ces res-sources. En 2013, le Groenland a modifié sa constitution afin d’autoriser l’exploration de son sous-sol. De son côté, la Russie a obtenu en 2015 un agrandissement de sa ZEE en mer d’Okhotsk en faisant valoir auprès des Nations unies l’extension du plateau continental. Deux ans plus tôt, une action des militants de Greenpeace sur la plateforme de Prirazlomnaia en mer de Petchora et leur détention par les autorités avaient très fortement médiatisé les ambitions de Moscou en Arctique.
En revanche, les États-Unis rencontrent davantage de difficultés. Après avoir obtenu un premier feu vert du gouvernement pour réaliser des forages dans le Beaufort et la mer de Tchouktches en 2012, la Royal Dutch Shell avait été contrainte d’abandonner ce projet après qu’une série d’incidents était survenue. En 2015, le président Barack Obama avait donné son accord à la reprise des activités en Alaska. Il avait alors suscité un tollé parmi les organisations écologistes et des manifestants en kayaks avaient pris l’initiative d’encercler une plateforme amarrée dans le port de Seattle.
Signalons que ces forages exigent une technologie très avancée – que ne maîtrisent pas toutes les entreprises du secteur extractif – et supposent des investissements massifs. La création de consortiums forme donc l’une des solutions privilégiées pour partager le portefeuille des risques. Or, comme la Chine détient une capacité à injecter des capitaux substantiels, elle est de facto devenue un interlocuteur incontournable. En 2012, la London Mining a par exemple fait savoir qu’elle souhaitait exploiter les minerais de fer du Groenland avec l’appui d’investisseurs chinois. En 2012, la Chine et l’Islande ont signé à Reykjavik six accords de coopération, dont un portant spécifiquement sur l’Arctique. Le texte comporte, entre autres, des dispositions concernant les sciences et technologies polaires, la géothermie, l’énergie solaire etc.
En assurant maintenant sa présence en Alaska, Pékin affirme son pouvoir structurel et démontre une capacité à se hisser au rang d’acteur majeur d’une gouvernance en voie d’élaboration.
Références
Escudé Camille, « Le Conseil de l’Arctique : la force des liens faibles », Politique étrangère, 3, aut. 2017, pp. 27-36.
Garcin Thierry, « Où en est la course à l’Arctique ? », Revue internationale et stratégique, 95 (3), 2014, pp. 139-147.
Lasserre Frédéric, « La stratégie de la Chine en Arctique : agressive ou opportuniste ? », Norois, 236 (3), 2015, pp. 7-23.
Nov 29, 2017 | Passage au crible, Politique symbolique, Prix Nobel
Par Josepha Laroche
Passage au crible n° 166
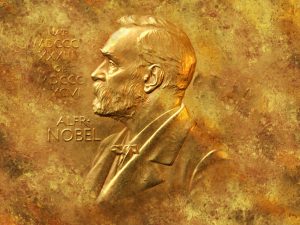
Source : pixabay
Le 9 octobre 2017, l’économiste américain Richard Thaler a reçu « le prix Nobel de la Banque de Suède en sciences économiques attribué en mémoire d’Alfred Nobel ». Ce théoricien a été ainsi honoré pour ses travaux en finance comportementale. Ses recherches ont plus particulièrement porté sur les mécanismes psychologiques et sociaux à l’œuvre chez les consommateurs et les investisseurs. Il a montré qu’ils étaient souvent, contre toute attente, loin de toute logique et de toute rationalité. Mobilisant pour ce faire l’apport de la psychologie et de la sociologie, le chercheur a souligné les « biais cognitifs » qui accompagnent les décisions de ces acteurs.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Dans son testament établi à Paris le 27 novembre 1895, Alfred Nobel a jeté les bases d’un système international de gratifications qui visait à préserver la paix mondiale. Institué pour la première fois en 1901, ce dispositif comprenait initialement cinq prix qui avaient pour objet de récompenser une œuvre dans les domaines suivants : chimie, littérature, physique, physiologie-médecine et paix. Devant la limitation des récompenses à ces seuls secteurs, il est apparu d’emblée que les mathématiques faisaient l’objet d’un ostracisme difficilement justifiable. À l’époque, les mathématiciens ont expliqué cette absence par les relations désastreuses opposant Alfred Nobel au mathématicien suédois Gosta Mittag-Leffler. Selon eux, le philanthrope aurait exclu leur science pour que son rival ne fût jamais en mesure d’être récompensé. En fait, il semblerait plutôt qu’aux yeux de l’industriel suédois, cette science ne permettait pas d’applications concrètes pouvant être rapidement profitables à l’humanité.
Pour répondre à cette préoccupation, tout en honorant la mémoire du donateur, la banque de Suède a décidé en 1968 – à l’occasion de son tricentenaire – de créer le prix d’économie. Ce dernier est décerné depuis 1969 dans les mêmes conditions d’attribution et de récompense que les autres prix. Cependant, il apparaît encore aujourd’hui comme une institution singulière dans la mesure où c’est le seul Nobel qui consacre une science sociale. Il représente même la seule gratification internationalement déterminante pour cette discipline. Outre la volonté de compléter les dispositions testamentaires en comblant une lacune importante, on notera le souci de vouloir élever cette discipline au même rang que celles qui avaient été distinguées personnellement par le mécène. Mais pourquoi avoir voulu ainsi rehausser le prestige de la science économique sur le plan international ?
Au cours des années soixante qui se sont caractérisées par une forte croissance économique, ce choix a entériné la reconnaissance de deux attributs singuliers : consacrer une rigoureuse mathématisation associée à une utilité sociale immédiate. Le choix de Ragnar Frisch et Jan Tinbergen (1969), fondateurs de l’économétrie, a bien traduit ce parti pris, comme plus tard dans la même spécialité ceux de Trygve Haavelmo (1989), James Heckman et Daniel McFadden (2000).
Choisir de distinguer et promouvoir ce savoir académique témoignait par ailleurs d’une vision optimiste du social. Désormais investie du pouvoir de prendre directement part à la décision politique, la science économique semblait ainsi susceptible de profiter à « l’humanité tout entière », et par conséquent en mesure de réaliser les vœux que le magnat avait explicitement formulés. Cette position a été illustrée par le profil même de certains lauréats, tels Friedrich von Hayek (1974), Herbert Simon (1978) et James Buchanan (1986) qui se sont toujours définis comme étant dans le même temps des sociologues et des économistes. Pour leur part, les théoriciens des jeux Reinhard Selten, John Harsanyi, John Forbes Nash (1994), Robert Aumann (2005) ou bien encore Roger Myerson, Leonid Hurwicz et Eric Maskin (2007) ont couvert des domaines très différents, tels que la philosophie politique et morale ou bien encore les mathématiques. Quant à Thomas C. Schelling (2005), il s’est rendu mondialement célèbre pour avoir appliqué la théorie économique à l’analyse de la politique étrangère et de la stratégie nucléaire. À ce titre, il occupe aujourd’hui une place éminente parmi les politistes. De la même façon, Daniel Kahneman et Vernon L. Smith (2002) ont associé leurs travaux d’économie à la psychologie pour le premier et au droit pour le second. Quant à Robert Shiller (2013), il a lui aussi été honoré pour ses recherches sur la « finance comportementale », tandis qu’Angus Deaton (2015) l’a été pour son analyse de la consommation et du bien-être. Autant d’économistes qui inscrivent leurs œuvres dans une acception très englobante de leur discipline.
Naturellement, cette large diversification des objets d’étude traduit dans le même temps une incontestable prétention hégémonique de la science économique. Mais l’apparition d’un prix Nobel qui lui soit dédié doit plus encore s’analyser comme la volonté de récompenser l’ensemble des sciences sociales.
Cadrage théorique
1. Une politique d’attribution globalisante. La décision du comité Nobel confirme une orientation doctrinale amorcée voici déjà plusieurs années. Celle-ci entend s’éloigner résolument d’un économicisme à la vision trop réductrice. Elle ambitionne de privilégier au contraire une approche qui fasse la part belle à l’interdisciplinarité et à la complémentarité entre toutes les sciences sociales.
2. La rationalité limitée de l’homo economicus. Cette posture épistémologique conduit à remettre en cause et à questionner la sacro-sainte rationalité que l’on prête aux acteurs sociaux, lorsqu’ils se font décideurs. Elle permet en revanche d’accorder une attention particulière aux erreurs économiques et d’en expliciter les causes psychiques.
Analyse
Cette année, parmi les favoris pressentis pour le Nobel d’économie, figurait notamment la Française Esther Duflo pour ses recherches sur l’économie de développement. Le nom de Paul Roomer était également évoqué pour ses travaux portant sur la connaissance définie comme une ressource génératrice de croissance économique. Enfin, de nombreux observateurs considéraient que les études relatives aux conséquences économiques du réchauffement climatique pourraient se trouver distinguées. Or, il n’en a rien été et l’Académie leur a préféré Richard H. Thaler. Diplômé de l’université de Rochester (États-Unis) et professeur à l’université de Chicago, ce dernier a montré comment certaines caractéristiques humaines, telles les limites de la rationalité ou bien les préférences sociales « affectent systématiquement les décisions individuelles et les orientations des marchés », a souligné le Secrétaire général de l’Académie royale des sciences.
Il a ensuite rappelé que l’économiste américain avait forgé le concept de « comptabilité mentale » qui permet de comprendre la façon dont les individus « simplifient la prise de décision en matière financière en créant des cases séparées dans leur tête, en se concentrant sur l’impact de chaque décision individuelle plutôt que sur l’effet global ». Enfin, il a ajouté que le théoricien avait aussi révélé « combien l’aversion aux pertes peut expliquer pourquoi les individus accordent une plus grande valeur à une chose s’ils la possèdent que s’ils ne la possèdent pas », un phénomène qualifié par lui d’« aversion à la dépossession ».
En l’occurrence, nous sommes donc bien loin de la microéconomie qui était encore récompensée l’an dernier avec l’Américano-Britannique Oliver Hart et le Finlandais Bengt Holmström, tous deux gratifiés pour leurs travaux sur « la théorie des contrats ». En effet cette année, le comité Nobel rompt avec une vision qui a très longtemps fait la part belle à la domination d’un certain économicisme. Un économicisme triomphant qui postule l’existence d’un homo economicus à la rationalité sans failles. Or, en pointant des formes systématiques d’incohérence présentes dans nos comportements, Thaler démontre que les acteurs sociaux agissent fréquemment contre leurs propres intérêts. Ce faisant, il souligne également la nécessité de faire appel à d’autres disciplines que la science économique pour expliciter cette complexité humaine. En d’autres termes, avec ce prix d’économie 2017, la doxa Nobel confirme une ligne doctrinale façonnée au fil du temps et qui s’emploie à distinguer l’ensemble des sciences sociales au travers du seul prix d’économie.
Références
Colliard Jean-Edouard, Emmeline Travers, Les Prix Nobel d’économie, Paris, La Découverte, 2009.
Laroche Josepha, Les Prix Nobel. Sociologie d’une élite transnationale, Montréal, Liber, 2012.
Roux Dominique, Soulié Daniel, Les Prix Nobel de Sciences économiques, Paris, Economica, 1991.