Fév 18, 2018 | Passage au crible, Santé publique mondiale, sécurité humaine
Par Clément Paule
Passage au crible n° 175

Source : Pixabay
Le 12 janvier 2018, le groupe agroalimentaire Lactalis a annoncé le rappel de tous les produits issus de son usine implantée à Craon, en Mayenne. Cette mesure concerne en l’espèce 12 millions de boîtes de lait infantile qui avaient été distribuées dans 83 pays, parmi lesquels l’Algérie et la Chine. Une telle opération n’intervient pourtant qu’un mois et demi après l’alerte lancée par le gouvernement français : plusieurs dizaines de cas de salmonellose avaient alors été décelés auprès de nourrissons ayant consommé ces substituts alimentaires. Provoquées par des entérobactéries de type Salmonella, ces infections – souvent bénignes pour les adultes – peuvent occasionner de sérieuses conséquences chez les jeunes enfants. Selon un bilan de Santé Publique France daté du 11 janvier 2018, 37 bébés auraient été atteints en France – aucun n’est décédé mais 18 d’entre eux ont été hospitalisés – tandis qu’une contamination a été confirmée en Espagne. Dans ces conditions, la décision exceptionnelle du géant laitier vise à contenir l’internationalisation d’une crise sanitaire qui ébranle de surcroît la régulation de l’IAA (industrie agroalimentaire).
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
En premier lieu, il importe de souligner l’établissement, dans la seconde moitié du XXe siècle, d’un marché oligopolistique de l’alimentation à l’échelle globale. Des conglomérats d’envergure planétaire se sont ainsi constitués en Europe et aux États-Unis, comme en témoigne l’essor fulgurant du groupe Lactalis. Créée en 1947, la société Besnier a en effet connu une croissance ininterrompue : citons le rachat de célèbres marques françaises – Lactel en 1984, Bridel en 1990, etc. – mais aussi de concurrents internationaux, à l’instar de Galbani et Parmalat acquis respectivement en 2006 et 2011. Rebaptisée Lactalis en 1999, la compagnie a également investi les marchés turc et états-unien, tout en implantant ses usines en Pologne, en Inde ou en Égypte. À tel point qu’elle est devenue le leader mondial de la transformation laitière, dépassant Nestlé et Danone. Son CA (chiffre d’affaires) annuel, qui a doublé en moins d’une décennie, s’élèverait à plus de 17 milliards d’euros en 2017. Employant 75 000 salariés au sein de 246 sites répartis dans une quarantaine de pays, Lactalis commercialise ses produits dans plus de 150 États.
Cette expansion spectaculaire a néanmoins été entachée de controverses : à titre d’exemple, l’une des filiales du groupe a été condamnée à une lourde amende en 2015 pour sa participation au « cartel du yaourt ». Dans une conjoncture de surproduction laitière en France, des petits producteurs ont récemment dénoncé les pratiques délétères de la firme qui imposerait inflexiblement des prix à la baisse. Face à ces accusations relayées par la presse, la direction de Lactalis s’est souvent retranchée dans le mutisme, justifié au besoin par le secret des affaires. Au-delà des turpitudes de cet acteur, l’IAA est confrontée à des scandales récurrents et transfrontaliers impliquant aussi bien les industriels que les réseaux de distribution. Parmi les plus récents, signalons l’affaire de la « viande de cheval » au début de l’année 2013 ou celle des œufs contaminés au fipronil – un produit phytosanitaire de toxicité modérée – pendant l’été 2017. L’accumulation de ces épisodes ne doit pourtant pas occulter une précédente épidémie de salmonellose, survenue en France en 2005. Près de 150 nourrissons avaient à l’époque été infectés par la Salmonella agona, et l’enquête avait incriminé la même usine de Craon qui appartenait à la laiterie Celia. L’année suivante, le site avait été racheté par Lactalis qui souhaitait investir le marché de la nutrition infantile. Or, les mesures de nettoyage semblent avoir été insuffisantes : entre 2005 et 2017, l’Institut Pasteur a recensé plusieurs dizaines de cas dont la souche bactérienne s’avère analogue à celle identifiée en novembre dernier.
Cadrage théorique
1. Une culture entrepreneuriale entretenant l’opacité. À rebours des rhétoriques célébrant la transparence, la direction de Lactalis se dérobe systématiquement à l’exposition médiatique. Selon ses détracteurs, cette obsession de la discrétion lui permettrait de limiter toute forme de reddition de comptes.
2. Stratégies d’évitement – blame avoidance. Dans la lignée de précédents scandales, les atermoiements des différents intervenants montrent les limites de l’autocontrôle, ainsi que les effets pervers d’une conception de la responsabilité qui apparaît étroitement procédurière.
Analyse
Cette crise alimentaire comporte plusieurs caractéristiques remarquables car elle met soudainement en cause la notoriété d’un fleuron de l’IAA, réputé pour son savoir-faire et sa discrétion. La santé de millions de nourrissons semble menacée par un produit de consommation courante, dont la qualité restait a priori garantie. Confrontée à une situation qui lui échappe rapidement, la direction de Lactalis se mure dans le silence et tarde à réagir publiquement. Il faut attendre le 11 janvier pour qu’un porte-parole présente des excuses aux parents des bébés affectés, tandis que son PDG (Président directeur général) Emmanuel Besnier – surnommé le « milliardaire invisible » par les journalistes – ne s’exprime dans la presse que six semaines après la première alerte. Cette désinvolture manifeste alimente d’autant plus les suspicions des consommateurs que la couverture médiatique se concentre sur les zones d’ombre d’un industriel méconnu. Plus encore, le gouvernement français incrimine ouvertement la faible coopération de Lactalis, le ministre de l’Économie stigmatisant une « entreprise défaillante » et des « comportements inacceptables ». L’intervention de Bercy témoigne de l’importance stratégique du dossier, dans un contexte de négociations ardues sur l’avenir de la filière laitière au sein du deuxième plus grand producteur de l’UE (Union européenne). Avec 25 milliards d’euros de CA annuel en 2017, il s’agit de l’un des rares secteurs dégageant un excédent commercial, ce qui éclaire les rapports de force autour de l’affaire. Certains élus et membres du MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) soutiennent par ailleurs le conglomérat laitier en dénonçant un « lynchage médiatique » contre un champion national.
Mentionnons ensuite les dysfonctionnements majeurs survenus dans la chaîne des intervenants censée mettre en œuvre les mesures de protection. Plusieurs campagnes de rappel de produits sont organisées en trois semaines, avant le retrait généralisé du 14 janvier. Si la première ne concerne que 200 000 boîtes, les suivantes ciblent des milliers de tonnes avant que les marques concernées ne soient suspendues de commercialisation et d’exportation. Or, les contrôles menés par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) démontrent que des dizaines d’établissements – grandes surfaces, pharmacies, grossistes, crèches et hôpitaux – ont continué de proposer des articles potentiellement contaminés malgré les consignes. À nouveau, les principaux distributeurs – E. Leclerc, Auchan, Carrefour ou Système U – ont tardé à admettre des « erreurs humaines », tout en déplorant des injonctions contradictoires et confuses. Autant d’errements qui ont suscité l’ouverture d’une enquête préliminaire pilotée par le pôle santé publique du parquet de Paris. En outre, de nombreuses plaintes ont été déposées par les parents affectés et des associations comme UFC-Que Choisir ou Foodwatch.
Le scandale Lactalis révèle de surcroît la faillite des dispositifs de surveillance régissant l’IAA. Au sein même du marché commun, les standards varient selon les pays, tout comme la capacité à les faire appliquer. Les gouvernements peuvent se montrer accommodants – à l’instar des autorités néerlandaises lors de l’affaire du fipronil – ou désarmés face à une firme rétive. Mais certains analystes déplorent une tendance à l’affaiblissement des administrations chargées d’assurer la sécurité alimentaire dans les pays de l’UE. Ce désengagement progressif de l’État – marqué par des suppressions de postes et une baisse des dotations – s’accompagne d’une régulation souple privilégiant l’autocontrôle par les industriels. Prévues tous les deux ans, les inspections de la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) se limitaient à certaines parties du site de Craon et s’appuyaient surtout sur les déclarations de l’entreprise. Or, cette dernière ne semble pas avoir transmis de multiples résultats positifs à la salmonelle, selon le directeur général de l’Alimentation. Réfutant toute dissimulation, le producteur incriminé s’est retranché derrière l’interprétation des procédures – comme la plupart des protagonistes de la crise – afin d’atténuer sa responsabilité. À long terme, ces tactiques d’évitement du blâme ne peuvent qu’entretenir la défiance envers des circuits complexes, glocalisés et tiraillés entre traçabilité et opacité.
Références
CNIEL (Centre national interprofessionnel de l’économie laitière), L’Économie laitière en chiffres. Édition 2017, Paris, CNIEL, printemps 2017.
Casalegno Elsa, Laske Karl, Les Cartels du lait. Comment ils remodèlent l’agriculture et précipitent la crise, Paris, Don Quichotte Éditions, 2016.
Jourdan-da Silva Nathalie et al, « Ongoing Nationwide Outbreak of Salmonella Agona Associated with Internationally Distributed Infant Milk Products, France, December 2017 », Eurosurveillance, (23), 2, janv. 2018.
Paule Clément, « Opacité de l’agroalimentaire, fragilité de la sécurité alimentaire. Le scandale de la viande de cheval, janvier-mars 2013 », in : Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible de la scène mondiale. L’actualité internationale 2013, Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 89-95, Coll. Chaos International.
Jan 29, 2018 | Industries culturelles, Passage au crible
Par Alexandre Bohas
Passage au crible n° 174
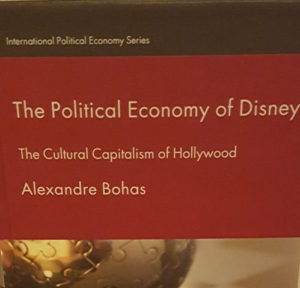 Disney qui connaît une période de succès cinématographiques et financiers sans précédent vient d’acquérir la Fox, une transaction le plus souvent saluée comme l’ultime triomphe de l’entreprise. Cependant, cette acquisition revêt un caractère défensif qui révèle la crise dans laquelle se trouvent les majors hollywoodiennes face à l’essor des opérateurs de l’internet.
Disney qui connaît une période de succès cinématographiques et financiers sans précédent vient d’acquérir la Fox, une transaction le plus souvent saluée comme l’ultime triomphe de l’entreprise. Cependant, cette acquisition revêt un caractère défensif qui révèle la crise dans laquelle se trouvent les majors hollywoodiennes face à l’essor des opérateurs de l’internet.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Après des rumeurs de pourparlers entre les deux parties révélées au mois de novembre 2017 par le site d’information CNBC, la compagnie Walt Disney annonce, le 14 décembre, avoir conclu un accord de rachat avec le groupe 21st Century Fox. Issu de la scission avec la News Corporation en juin 2013, celui-ci rassemble l’ensemble des actifs audiovisuels détenus par le magnat Rupert Murdoch, dont la major 20th Century Fox avec ses studios et ses univers narratifs, les réseaux de diffusion mondiale et le network américain, Fox. Alors que ce dernier serait exclu de la transaction, le reste du groupe serait acquis pour un montant de 66 milliards de dollars dont 14 seraient destinés à rembourser sa dette. Dès la conférence de presse officialisant le rapprochement, de nombreuses synergies ont été annoncées. Estimées à 2,5 milliards de dollars, elles devraient concerner la production et la distribution tant cinématographiques que télévisuelles. Notons que cette prise de contrôle ne sera pas définitive avant l’accord de l’administration américaine qui devrait se produire au début de l’année 2019.
La firme ainsi rachetée a dernièrement connu des scandales en matière de harcèlement sexuel ainsi que des contre-performances audiovisuelles. En effet, ses deux figures emblématiques, Bill O’Reilly et Roger Ailes, ont été acculées à la démission après des plaintes les visant. Par ailleurs, ses productions de cinéma ne s’avèrent plus aussi rentables que par le passé, tandis que le nombre des abonnements à ses offres de services par satellite stagne. Soulignons en particulier que les chaînes spécialisées dans les événements sportifs, auparavant sources majeures de revenus, n’attirent plus autant les téléspectateurs.
Par ce tour de force, Disney acquiert tant la prestigieuse major 20th Century Fox et ses nombreux labels, comme Fox Searchlight et Fox 2000, que de puissants réseaux de télévision par satellite asiatiques et européens, notamment Sky et Star. Elle étoffe également son catalogue d’univers narratifs avec Avatar, les X-Men, l’Age de Glace et les Sympsons, qui serviront à de nouveaux épisodes cinématographiques. Ce faisant, elle poursuit une stratégie de croissance externe. Elle devient aussi majoritaire dans le capital de la plateforme de streaming vidéo, Hulu, qui compte déjà 35 millions d’abonnés, ce qui conforte son PDG, Robert Iger, dans sa volonté de développer sa propre plateforme internet de vidéo en streaming pour contrer la position hégémonique de Netflix et d’Amazon dans le domaine.
Cadrage théorique
1. Une confrontation entre économies-mondes. Fernand Braudel désignait par ce dernier concept des territoires déterminés et hiérarchisés, de manière transnationale, autour de centres qui dominent des périphéries. La reconfiguration résultant du processus de mondialisation abat les frontières entre secteurs, ce qui multiplie les rivalités entre pôles mondiaux ; en l’occurrence, dans le cas présent, Hollywood et la Silicon Valley.
2. L’essor des plateformes numériques dans les industries culturelles. Ce que d’aucuns désignent par le terme d’uberisation de l’économie renvoie au succès de sites internet qui mettent en lien, de manière instantanée, efficace et pratique, une offre à une demande (Van Alstyne, Parker, Choudary ; PAC 153). En l’espèce, dans le domaine des biens culturels, de nombreux opérateurs, tels que Netflix, proposent un modèle économique plus attractif et créateur de valeur que celui des diffuseurs traditionnels.
Analyse
Ce rachat de la Fox par Disney intervient dans un contexte de crise des majors d’Hollywood. En effet, leurs taux de rentabilité baissent à la suite d’effets ciseaux provenant de l’augmentation des coûts de production et de la baisse des ventes.
D’une part, les montants investis dans les films ont dramatiquement augmenté ces dernières années, passant de 80 millions de dollars en moyenne dans les années 2000 à plus de 150 aujourd’hui, sans compter les dépenses engagées pour leur promotion et leur diffusion. Délaissant les longs métrages à budgets modérés, les majors se sont concentrées sur les films à succès destinés aux familles, appelés blockbusters ou tentpoles. Disney s’avère emblématique de cette spécialisation, détenant de nombreux univers narratifs comme ceux de Pixar, de Marvel et de Star Wars.
D’autre part, les spectateurs se détournent des supports vidéo, de la télévision traditionnelle, et des multiplexes pour se diriger vers la vidéo en streaming, ce qui réduit d’autant les sources de revenus et de rentabilité des majors. À titre d’exemple, les divisions home entertainment des majors, en charge des supports vidéo, ont vu leurs ventes divisées par deux en dix ans, alors qu’elles constituaient une manne essentielle pour leurs résultats. Les internautes se sont habitués à visionner des contenus gratuits, ce qui constitue un défi, notamment pour les programmes spécialisés dans le sport. À cet égard, la chaîne de Disney ESPN connaît une baisse du nombre de ses abonnements. Pour ce qui concerne les offres de vidéo en streaming par internet – segment en croissance, rentable et offrant un accès direct vers les spectateurs – les majors hollywoodiennes se trouvent distancées par les opérateurs de l’internet, notamment par Netflix avec 100 millions d’abonnés et Amazon avec plus de 80. Les plateformes des majors telles que Hulu et HBO en totalisent moins de 50. Notons qu’Hollywood se trouve, une fois de plus, en retard sur les grandes évolutions du secteur de l’information et des télécommunications comme lors de l’émergence de la télévision, de la cassette vidéo et de l’internet durant les années 2000.
Dans ce contexte de transformation de la consommation audiovisuelle et d’arrivée de nouveaux rivaux, les majors hollywoodiennes risquent de se trouver à la merci de quelques startups de la Silicon Valley, qui leur échappent, les mettent en concurrence et se lancent dans des productions audiovisuelles de séries télévisées et de cinéma. Ainsi, la concentration d’Hollywood vise-t-elle à renforcer le pouvoir de négociation du nouveau conglomérat audiovisuel à l’égard de ses clients, mais aussi à contrer la prédominance des opérateurs de l’internet en matière de contenus audiovisuels.
En somme, cette prise de contrôle de Disney sur la 20th Century Fox constitue avant tout une action défensive traduisant la vulnérabilité des majors face à l’essor de la sphère numérique. Comme Uber dans les services de transport individuels et Airbnb dans l’industrie hôtelière, les plateformes de diffusion vidéo introduisent une rupture radicale dans les secteurs de l’audiovisuel.
Références
Bohas Alexandre, « Uber ou l’irrésistible ascension mondiale des firmes numériques », Passage au crible, (153).
Braudel Fernand, La Dynamique du capitalisme, Paris, Arthaud, 1985.
Faughnder Ryan, NgContact David, « Disney’s Deal to Buy Fox Studio Could Bring Substantial Layoffs”, Analysts Say », Los Angeles Times, 14 December 2017.
Van Alstyne Marshall W., Parker Geoffrey G., Choudary Sangeet Paul, « Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy », Harvard Business Review, April 2016.
Déc 31, 2017 | Diplomatie, Industrie numérique, Passage au crible
Par Adrien Cherqui
Passage au crible n° 173
 Source: Chaos International
Source: Chaos International
Le 18 décembre 2017, l’éditeur de solutions antivirus Kaspersky Lab a annoncé « vouloir faire appel, devant la cour fédérale, de la décision du Département de la Sécurité nationale américain […] interdisant l’utilisation des produits de la société dans les organismes fédéraux ». Pour l’entreprise, cette conclusion serait « inconstitutionnelle » et fondée simplement sur « des allégations et des rumeurs ».
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Avec près de 400 millions d’utilisateurs et 644 millions de dollars de recettes en 2016, la firme russe créée en 1997 par Eugene Kaspersky et Natalya Kasperskaya fait figure de leader mondial dans le secteur de la cybersécurité. Récemment, les tensions internationales entre la Russie et les États-Unis ont marqué son histoire. En témoigne l’évaluation secrète de la CIA (Central Intelligence Agency) révélée par le Washington Post et suivant laquelle la Russie aurait interféré dans le processus de la présidentielle américaine de 2016. Par l’intermédiaire de Wikileaks, nombre de cyberattaques ont alors mis au jour des emails piratés provenant des comptes de John Podesta, le directeur de campagne de l’ex-candidate Hillary Clinton, et du parti démocrate. Diverses organisations pirates, dont Cozy Bear et Fancy Bear, toutes deux prétendument proches du Kremlin, ont alors été désignées comme responsables.
Depuis cet imbroglio diplomatique, Kaspersky Lab a rapidement été considérée comme le cheval de Troie du Kremlin. Ainsi, dès le mois de février 2017, deux officiers supérieurs du FSB (Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie), Sergueï Mikhaïlov, Dmitri Dokoutchaïev et un dirigeant du laboratoire Kaspersky ont été inculpés pour trahison au profit des États-Unis. Puis, le 11 mai 2017, le United States Intelligence Community a indiqué qu’il enquêtait sur l’emploi des applications Kaspersky par l’administration fédérale, tandis que les sénateurs américains ont craint de voir le renseignement russe exploiter les outils de Kaspersky Lab à des fins de surveillance. Aussitôt, le groupe industriel a publié un démenti déclarant qu’en tant que « société privée, [elle] n’a de lien avec aucun gouvernement et [qu’elle] n’a jamais aidé, et n’aidera jamais, aucun gouvernement au monde dans ses activités de cyber-espionnage ». Sur cette question, le Département américain de la sécurité intérieure dirigé par Elaine Duke aurait publié un rapport secret.
Après cette rencontre, la commission sénatoriale des Forces armées américaines a adopté un projet de loi de dépenses prévoyant d’interdire à l’armée l’achat de softwares produits par Kaspersky Lab. En juillet 2017, poursuivant leur action à son encontre, les États-Unis l’ont retirée de deux listes de la GSA (General Services Administration) des vendeurs d’équipement technologique agréés auprès des agences gouvernementales. Dans cette logique d’incrimination, le FBI (Federal Bureau of Investigation) a demandé aux professionnels du pays de cesser de recourir à l’antivirus Kaspersky, considérant que ses solutions représentent « une menace pour la sécurité nationale ». En outre, d’après une enquête de Bloomberg, des courriels internes de Kaspersky Lab datant de 2009 ont montré que cette société privée aurait entretenu une relation étroite avec le FSB et lui aurait fourni une technologie dans le cadre d’un programme mené par Igor Chekunov, directeur juridique de Kaspersky Lab et ancien membre du KGB (Comité pour la Sécurité de l’État de l’ex-URSS).
Devant de telles suspicions de collusion, le 13 septembre 2017, Elaine Duke a ordonné aux fonctionnaires de désinstaller des systèmes d’information fédéraux tous les logiciels conçus par Kaspersky Lab ; la mesure devant être effective sous trois mois. Cette responsable a en effet estimé que la Russie pouvait être en mesure de contraindre légalement ce géant du numérique à l’assister dans ses opérations d’espionnage et d’interception des communications. Appelé à venir s’exprimer devant le Congrès américain, Eugene Kaspersky a accepté l’invitation avant que cette entrevue ne soit reportée sans qu’il ne soit ensuite convié de nouveau.
Cette décision a été suivie, en France, par la DIRISI (Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense) qui n’a pas retenu Kaspersky Lab pour de nombreux appels d’offres. Craignant davantage des actes de sabotage, le ministère français des Armées considère « que sa démarche […] conduit à ne pas accorder une place prépondérante à un antivirus en particulier ». Le Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni a quant à lui averti des dangers encourus par l’utilisation de Kaspersky dans les infrastructures sensibles.
Finalement, le Wall Street Journal révèle le 5 octobre 2017 que le logiciel mis au point par Kasperksy Lab aurait été piraté par les services de renseignement israéliens. Cette intrusion aurait permis de découvrir que des espions russes avaient dérobé, en 2015, des informations sur les programmes de la NSA utilisés pour pénétrer les ordinateurs de cibles étrangères. Face à cette vaste controverse, Eugene Kaspersky a annoncé que sa firme allait créer prochainement trois Transparency Centers en Europe, en Amérique et en Asie. Elle y mettra à disposition son code source et ses bases de données pour inspection. Un projet qui a été suivi début décembre par la fermeture de ses bureaux situés à Washington alors que l’on a appris en novembre via Wikileaks que la CIA avait falsifié des certificats web délivrés par Kaspersky Lab.
Cadrage théorique
1. La remise en cause du modèle décisionniste. Le postulat d’un acteur unique et rationnel a été invalidé par le politiste américain Graham Allison. Dans son célèbre ouvrage The Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, l’auteur a bien mis en lumière la pluralité des intervenants qui participent au processus décisionnel. Il a ainsi incontestablement montré que ce dernier était loin d’être univoque. Or, la position américaine relative à Kaspersky Lab confirme précisément ce manque d’unicité et révèle au contraire une politique étrangère sujette à un marchandage constant entre organisations aux intérêts distincts.
2. Le pouvoir structurel des États-Unis. Forgé par Susan Strange, le concept de pouvoir structurel renvoie à la faculté de certains intervenants de façonner les relations internationales. Il désigne de manière inclusive les structures du savoir, de la production et de la sécurité. Bien que la mondialisation de l’économie ait réduit la capacité opérationnelle des acteurs étatiques, les États-Unis ont su en revanche maintenir la leur dans certains domaines. En l’occurrence, force est de constater qu’en fermant son marché intérieur à Kaspersky Lab et en barrant indirectement l’accès à celui d’autres pays, la puissance américaine pèse substantiellement sur le secteur de la cybersécurité et l’ensemble de ses parties prenantes.
Analyse
Lors de son investiture à la tête des États-Unis, Donald Trump espérait établir des « rapports fantastiques » avec la Russie. Rappelons qu’il semblait initialement envoyer des signaux favorables à une levée des sanctions mises en place dans le cadre du conflit en Crimée et de l’implication russe présumée favorable à son élection. Or depuis, les relations américano-russes post Guerre froide ont pourtant rarement été aussi mauvaises.
L’affaire diplomatico-économique incriminant Kaspersky Lab souligne l’existence de nouvelles dynamiques sous-jacentes à la diplomatie américaine et met en exergue les tensions l’opposant à la Russie. Son exclusion progressive du marché jette les bases d’une politique étrangère qui reste soumise à des tractations bureaucratiques entre des opérateurs interdépendants émanant de milieux bien distincts. Pour ce faire, cette politique extérieure se fonde sur l’impérieuse défense de l’État et la protection de son intérêt national. En effet, l’accumulation de preuves au fil des années à l’encontre de Kaspersky Lab semble démontrer sa loyauté envers le régime de Vladimir Poutine. Notons ici que son PDG a servi dans l’armée russe comme officier du renseignement après avoir suivi pendant cinq ans une formation dans un institut de cryptographie financé en partie par le KGB. Ces éléments lèvent le voile sur l’interdépendance existant entre les structures étatiques et les opérateurs privés. Grâce à cette intrication hétérodoxe entre des acteurs provenant des sphères privée et publique, la Russie réaffirme sa puissance et sa présence incontournable dans les affaires internationales. En somme, ce partage de ressources assure au Kremlin une diversification de son répertoire d’action qui lui permet de contourner le droit international, voire parfois d’y échapper. Contre toute attente, cette configuration complexe tend à battre en brèche l’hypothèse suivant laquelle Moscou n’aurait plus les moyens de mener des campagnes d’espionnage et devrait désormais recourir à des éléments extérieurs. À rebours de la fameuse thèse du retrait de l’État, nombre d’analystes considèrent la possibilité d’une sponsorisation de hackers par l’État russe. Un patronage officieux de ressources criminelles qui s’apparenterait en quelque sorte aux pratiques d’un État voyou ne reconnaissant pas, par définition, la légitimité des règles internationales.
Cette dangereuse collusion toujours possible au sein de la cybersécurité contribue à l’attrait croissant des gouvernements pour les logiciels souverains, comme le reflète l’initiative française de 2011 visant le développement d’un antivirus tricolore de nouvelle génération et de confiance. Destiné à un large marché incluant les opérateurs d’importance vitale, il bénéficiait dans l’Hexagone de l’appui du monde industriel. Il faut voir là l’expression directe d’une souveraineté numérique, celle dans laquelle l’État se trouve en position d’exercer une domination légitime et inaliénable sur son environnement dématérialisé.
Malgré la multiplication des acteurs participant à l’orientation de la diplomatie américaine, les États-Unis ont su imposer leur décision et justifier leur position internationalement en s’adressant tout à la fois à la sphère privée et au secteur public. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur les considérations d’une communauté épistémique d’experts en sécurité de l’information et sur des groupements de domination disposant d’une légitimité légale-rationnelle, telles que les agences fédérales. En outre, le réseau d’alliances mis en place par Washington lui a procuré un incontestable soutien. Ainsi, le Royaume-Uni et la France ont-ils par exemple appliqué à Kasperksy les mêmes principes d’exclusion que leur allié américain. Eux aussi se sont fondés sur les notions de souveraineté et de sécurité collective. En d’autres termes, nous sommes en présence d’une arène multilatérale qui intègre certes aussi bien des acteurs étatiques que non-étatiques, mais qui reste surtout dominée par la puissance structurelle de l’hegemon américain. En effet, ce dernier a réussi à reconfigurer toute l’économie mondiale de la cybersécurité en affaiblissant commercialement le groupe russe dont 85% des recettes proviennent de ses ventes à l’étranger. Mieux, l’État américain est parvenu à le marginaliser – sinon à l’éliminer – symboliquement.
Finalement, à travers la réorganisation d’un secteur économique clé en plein essor, se dessine la nouvelle politique étrangère de la Maison-Blanche ; une politique transactionnelle qui fait écho au slogan lancé durant la campagne présidentielle de Donald Trump : « America first ».
Références
Allison Graham T., Zelikow Philip, The Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, London, Pearson, 1999.
Charillon Frédéric (Éd.), Politique étrangère, nouveaux regards, Paris, Presses de Sciences Po, 2002..
Dungan Nicholas, « Une politique étrangère des États-Unis plus imprévisible », La Dépêche, 10 nov. 2016, article disponible à l’adresse : https://www.ladepeche.fr/article/2016/11/10/2456105-une-politique-etrangere-des-etats-unis-plus-imprevisible.html
« Industrie de la cybersécurité: Quelles synergies public-privé? », Observatoire du Monde Cybernétique, 40, 2015, pp. 2-6.
Laroche Josepha (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2013, Paris, L’Harmattan, 2013. Coll. Chaos International.
« Le rôle essentiel du secteur privé en matière de renseignement cyber », Observatoire du Monde Cybernétique, 65, 2017, pp. 8-15.
« Le rôle stratégique des éditeurs d’antivirus », Observatoire du monde cybernétique, 37,2015, pp. 1-4.
McLaughlin Jenna, Tamkin Emily, « Under Trump, U.S.-Russian Relations Hit New Low », Foreign Policy, jul. 2017, article disponible à l’adresse : http://foreignpolicy.com/2017/07/06/under-trump-u-s-russian-relations-hit-new-low/
Solon Olivia, « US government Bans Agencies from using Kaspersky Software over Spying Fears », The Guardian, 13 septembre 2017, disponible à l’adresse : https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/13/us-government-bans-kaspersky-lab-russian-spying
Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, trad., Paris, Temps Présent, 2011.
Strange Susan, « States, Firms and Diplomacy », International Affairs, 68 (1), 1992, pp. 1-15.
Wallerstein Immanuel, « La politique étrangère de Donald Trump », Mémoire des luttes, 17 novembre 2017, disponible à l’adresse : http://www.medelu.org/La-politique-etrangere-de-Donald,2689
Déc 30, 2017 | Passage au crible, Politique étrangère
Par Thierry Garcin
Passsage au crible n° 172

Source: Pixabay
Le 6 décembre 2017, le président américain Donald Trump déclare que « l’heure est venue pour les États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël [...] Je pense que cela aurait dû être fait depuis longtemps ».
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Au cœur de la Grande Guerre, le Royaume-Uni et la France (en association avec la Russie tsariste) prévoient de dépecer l’empire ottoman, « homme malade de l’Europe ». Mais ces accords secrets dits « Sykes-Picot » (1916) ne seront jamais appliqués. L’année suivante, la déclaration Balfour, du nom du ministre britannique des Affaires étrangères, promet un « foyer national pour le peuple juif ». En 1918, la déclaration du président Wilson (les fameux « 14 points ») entre également en résonance avec la question du Levant. Le 12e point est explicite : « Aux régions turques de l’Empire ottoman actuel devront être garanties la souveraineté et la sécurité ; mais aux autres nations qui sont maintenant sous la domination turque, on devra garantir une sécurité absolue d’existence et la pleine possibilité de se développer d’une façon autonome, sans être aucunement molestées […] ».
En 1919, la SDN (Société des nations), à laquelle n’adhéreront finalement pas les États-Unis (le congrès américain ayant refusé de ratifier le traité de Versailles), confie au Royaume-Uni et à la France des tutelles de type A (1920), qui devront préparer les peuples concernés à l’indépendance, ceux-ci n’étant pas encore considérés comme capables « de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne » (article 22 du Pacte de la SDN). À Londres, la Palestine, la Transjordanie et l’Irak ; à Paris, la Syrie et le Liban, ainsi qu’une frange territoriale de la Turquie du sud-est (cette dernière sera restituée à la Turquie en 1921). Les deux puissances agissent alors « en qualité de mandataires et au nom de la Société ».
D’emblée, il est prévu une « administration internationale » pour la ville de Jérusalem (« ville de la paix »), qui abrite les lieux saints des trois seules religions monothéistes : le Mur des Lamentations pour le judaïsme, le Golgotha pour le christianisme, le dôme du Rocher jouxtant la Grande mosquée pour l’islam. Ce statut sera rappelé par la SDN à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Après la tragédie de l’holocauste, l’Assemblée générale de l’ONU (Organisation des nations unies) vote un plan de partage entre État palestinien et État juif (résolution 181, 29 novembre 1947), instituant un « corpus separatum » pour Jérusalem, sous l’autorité administrative de l’ONU (assurée par un gouverneur, ni juif ni arabe), avec « régime international particulier » pour une période de dix ans. Il est prévu que les lieux saints soient libres d’accès et démilitarisés. « Tous les résidents deviendront ipso facto citoyens de la Ville de Jérusalem », sauf à choisir la nationalité de l’État arabe ou de l’État juif. Le plan de partage ayant été refusé par les États arabes, l’État d’Israël proclame son indépendance le 14 mai 1948. Jérusalem-Ouest sera déclarée capitale en 1950. La partie orientale de Jérusalem (dont la vieille ville accueillant les lieux saints) est alors administrée par la Jordanie, sous réserve de la résolution finale de la question palestinienne.
En 1967, à l’issue de la guerre des Six-Jours déclenchée par Israël, Jérusalem-Est est occupée, résolument colonisée dès la décennie soixante-dix et finalement annexée par le vote d’une loi fondamentale adoptée par la Knesset en 1980. Elle devient ainsi capitale « éternelle et indivisible ». La résolution 478 du Conseil de sécurité de l’ONU (1980) demande aux quelques États « qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem (i.e. : à Jérusalem-Ouest) de retirer ces missions de la Ville sainte». Quant à la municipalité du Grand Jérusalem, elle déborde d’une façon significative sur la Cisjordanie (depuis 1995, la superficie de Jérusalem-Est a été multipliée par douze, après confiscation ou destruction d’habitations palestiniennes, dénoncées par les États-Unis). En 1988, l’année suivant la première Intifada (« révolte des pierres »), la Jordanie se désengage de son administration civile de la Cisjordanie. En 1993, les accords d’Oslo (Israël-OLP) prévoient un statut définitif pour la Palestine (et pour Jérusalem) au plus tard en 1999. En 2002, un mur commence à être érigé par Israël (au motif de la lutte anti-terroriste), empiétant sur la Cisjordanie (il sera considéré comme « illégal » dans un avis consultatif émis en 2004 par la CIJ (Cour internationale de justice des Nations unies). Ce mur enferme des Palestiniens dans la municipalité du Grand Jérusalem et leur interdit de rejoindre aisément la Cisjordanie, tout en privilégiant la colonisation de Jérusalem-Est. Enfin, en 2003, la « Feuille de route » (États-Unis, Russie, Union européenne, ONU- dit le « Quatuor ») annonce la création d’un État palestinien pour 2005, avec « un règlement négocié de la question du statut de Jérusalem qui tienne compte des préoccupations politiques et religieuses des deux parties ».
Cadrage théorique
1. Les territoires occupés. Une douzaine de territoires sont militairement occupés dans le monde, pour des raisons religieuses, politiques et/ou identitaires. Ces situations impliquent directement le recours à la force armée, le droit international et l’ONU, la question des frontières restant première, en particulier dans un lieu aussi symbolique que Jérusalem.
2. La Religion et la souveraineté. On assiste à une véritable intrication des arguments d’ordre religieux (la Judée-Samarie, biblique) ou politiques, qui associent les pays de la région mais qui nourrissent aussi des thématiques complexes comme la création d‘un État de Palestine bicéphale (La Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza) et des dossiers tels que l’avenir des colons, le droit au retour des réfugiés, l’eau, qui avaient eux-mêmes fait l’objet de négociations dans le cadre de la Conférence de paix sur le Moyen-Orient (1991-1994).
Analyse
La décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël (dans des frontières israéliennes et internationales non précisées) et d’y installer à terme l’ambassade, respectant en cela l’une des promesses de sa campagne électorale, ne saurait être dissociée de la question de la Palestine (Cisjordanie, Jérusalem-Est, bande de Gaza décolonisée et évacuée par Israël en 2005).
Certes, en 1995, le Jerusalem Embassy Act avait été voté par le congrès (93 sénateurs sur 100, 374 représentants sur 435), demandant la relocalisation de l’ambassade à Jérusalem. Mais les présidents américains successifs avaient pris soin de signer chaque semestre un report de la décision (dérogation), au nom « des intérêts de sécurité nationale ». La déclaration du président Trump change donc la donne, au point que ses détracteurs arabes ou européens accusent les États-Unis de ne plus être un «médiateur impartial ».
Tout d’abord, le contexte doit être précisé, à trois niveaux différents. En premier lieu, celui interne à Israël (reculade du gouvernement dans la « crise des portiques » de l’été 2017 ; accusations de corruption poursuivant le Premier ministre ; reprise de la colonisation) et propre aux États-Unis (affaires concernant directement le président, à un an des élections de mi-mandat). Ensuite, celui des Palestiniens (Autorité palestinienne affaiblie ; annonce d’une nouvelle réconciliation entre celle-ci et le Hamas, qui dirige la bande de Gaza depuis 2007). Enfin, la situation internationale (rapprochement entre les États-Unis, Israël et l’Arabie Saoudite ; crainte de la montée en puissance de l’Iran).
Si le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, s’est félicité de la décision américaine, plus unilatéraliste qu’isolationniste, arguant du fait que Jérusalem était la « propriété depuis 3 000 ans du peuple juif », le président de l’Autorité palestinienne a récusé en revanche toute future entremise diplomatique des États-Unis, tandis que le Hamas a appelé à l’Intifada. La question palestinienne reste donc dépendante de puissants facteurs exogènes et ravive la problématique « Paix contre territoires ». Le débat est rapidement devenu diplomatique : risque d’isolement des États-Unis, affaiblissement du dirigeant de l’Autorité palestinienne ; hostilité déclarée de la Turquie qui a aussitôt convoqué un sommet de l’OCI (Organisation de la coopération islamique). Vue de Washington, la réaction d’Ankara accentue encore les dissensions internes à l’Alliance atlantique (occupation de Chypre du Nord, politique migratoire, respect de l’État de droit, lutte contre l’État islamique, répression contre les Kurdes). Mais, l’embarras fut perceptible chez certains partenaires arabes, et davantage en Arabie Saoudite ou en Égypte qu’en Jordanie ou au Maroc. Une nouvelle fois, l’unité ou la solidarité du monde arabe a été mise à l’épreuve.
Les réactions n’ont pas été plus unanimes au sein de l’Union européenne : le président français Emmanuel Macron a regretté, puis désapprouvé sans condamner ; l’Allemagne a rappelé la nécessité d’une solution impliquant deux États ; le Royaume-Uni a dénoncé une décision « sapant les perspectives de paix dans la région ». Et si Federica Mogherini, haute représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, a affirmé : « Nous pensons que la seule solution réaliste au conflit entre Israël et la Palestine est fondée sur deux États, avec Jérusalem comme capitale des deux États, suivant les frontières de 1967 », la Hongrie a fait bande à part. À nouveau, la politique étrangère et de sécurité commune s’est donc retrouvée face à des défis majeurs.
De même, de nombreux pays subsahariens n’ont pas tardé à réagir ou à critiquer, voire à condamner. Les observateurs ont remarqué que la Chine se montrait a contrario plus conciliante. En effet, sur un dossier dans lequel elle n’est active que depuis 2013, elle appelle à la reconnaissance de Jérusalem-Est comme capitale du futur État palestinien et promet une aide économique financière. Il faut y voir la limite de la politique étrangère chinoise dans la région, Pékin restant fortement tributaire des pays arabes et de l’Iran pour son approvisionnement en matières premières. L’Assemblée générale de l’ONU a voté, le 21 décembre, à une large majorité (128 voix sur 193 pays), en faveur d’une résolution sur le statut de Jérusalem condamnant implicitement la décision américaine, s’opposant de facto au veto américain précédemment utilisé au Conseil de sécurité.
Cette nouvelle situation illustre l’hétérogénéité des prises de position des principaux acteurs de la région, les divergences propres aux organisations arabes, islamiques et européennes, la montée en puissance des pays tiers et, finalement, l’instabilité du système international.
Références
Chagnollaud Jean-Paul, Israël/Palestine. La défaite du vainqueur, Arles, Sindbad Actes Sud, 2017, pp. 95-113.
Dot-Pouillard Nicolas, La Mosaïque éclatée. Une histoire du mouvement national palestinien (1993-2016), Arles, Actes Sud, 2016, 255 p.
Lemire Vincent (Éd.), Jérusalem, histoire d’une ville monde, Paris, Champs-Flammarion, 2016, 535 p.
Déc 29, 2017 | Droits de l'homme, Mondialisation, Passage au crible
Par Alexandre Bohas
Passage au crible n° 171

Source: Pixabay
À l’automne 2017, les révélations portant sur les agissements criminels d’Harvey Weinstein à l’égard des femmes, ont provoqué une indignation et une mobilisation sans précédent à l’échelle mondiale. Cette lutte contre le harcèlement sexuel témoigne de l’existence de dynamiques transnationales qui annoncent des changements sociaux de fond.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Le 5 octobre 2017, deux journalistes du New York Times, Jodi Kantor et Megan Twohey, ont publié une enquête qui a mis en lumière le comportement inapproprié du producteur hollywoodien, Harvey Weinstein, envers ses employées et certaines actrices de ses films. Ces informations se fondaient en particulier sur les déclarations de plusieurs de ces femmes parmi lesquelles se trouvaient deux stars, Ashley Judd et Rose Mcgowan. Après cette publication, les témoignages se sont multipliés sur les pratiques immorales et abjectes que cette figure d’Hollywood aurait fait subir à de nombreuses femmes, révélant ainsi des abus perpétrés depuis plusieurs décennies. Au total, quatre-vingt-dix personnes se sont dites victimes, dont quatorze invoquant des viols. Parmi elles, on note des vedettes mondialement connues, telles qu’Angelina Jolie et Gwyneth Paltrow.
Ces divulgations ont suscité un émoi planétaire qui a encouragé des milliers de femmes, connues ou non – et ayant subi les mêmes outrages – à sortir également de leur silence. À cet égard, les réseaux sociaux ont pleinement joué un rôle de caisse de résonance. En effet, en quelques semaines, des centaines de milliers de messages relatant des cas similaires ont été publiés dans quatre-vingt-cinq pays, sous les mots-clés suivants : « #Metoo », « balanceTonPorc » en France, « #QuellaVoltaChe » et « #YoTambién » dans les pays hispanophones. Dans ce cas d’espèce, c’est la méthode d’humiliation et de dénonciation (shaming and naming) ayant déjà démontré son efficacité depuis plusieurs années, qui a été mise en œuvre à l’échelle mondiale. Des dizaines d’artistes tels que Kevin Spacey, d’universitaires comme Tariq Ramadan et d’hommes politiques – tels que l’ancien Président George H.W. Bush – ont été accusés publiquement. Au Royaume-Uni, l’ensemble de la classe politique a été frappé : de nombreux parlementaires et des ministres ont été directement mis en cause. Dans le gouvernement de Theresa May, Michael Fallon a été acculé en novembre dernier à la démission en raison des allégations portées à son encontre. L’onde de choc a même atteint des pays non occidentaux comme la Chine, le Japon ou bien encore la Russie.
À la suite de ces messages en ligne, des manifestations à l’appel de collectifs, ont été organisées aux États-Unis et en Europe. En outre, des projets de loi sont en cours d’élaboration afin de pouvoir engager plus facilement des recours contre les harceleurs et de durcir les peines relatives aux actes incriminés. Enfin, notons qu’une hausse des plaintes pour violences sexuelles a d’ores et déjà été enregistrée depuis ces événements.
Cadrage théorique
1. La prépondérance américaine dans la sphère des savoirs. Le processus de mondialisation provoque l’enchevêtrement des économies, mais aussi celui des cultures nationales, au profit des États-Unis d’Amérique qui y occupent une place dominante. De ce fait, ses courants d’opinion et ses modes de pensée induisent des dynamiques de transformations transnationales dans la structure des savoirs. Ces modifications déterminent ce que les individus croient et prennent pour acquis. Ainsi, une part fondamentale du pouvoir structurel des États-Unis provient-elle de ce façonnement d’ordre culturel (Strange).
2. La puissance du star-system mondial. Au cours des XIXe et XXe siècles, la figure de l’écrivain-intellectuel universel s’est imposée dans les débats publics. Mais aujourd’hui, lui succède celle de la star détentrice d’un rayonnement international. En effet, le charisme, que permet la participation à des créations audiovisuelles au succès planétaire, lui confère un capital symbolique propre à mobiliser les opinions publiques. Par leur célébrité, les stars se révèlent alors en mesure de faire inscrire certaines de leurs priorités à l’agenda politique de la scène mondiale.
Analyse
Rappelons que monde audiovisuel a connu de nombreuses affaires de mœurs qui ont déjà fait la une de l’actualité, comme celles des deux figures de la chaîne Fox news, Roger Ailes et Bill O’Reilly et celle de l’acteur à succès, Bill Cosby. Néanmoins, les révélations actuelles, amplifiées par les réseaux sociaux, revêtent un retentissement nouveau dû à l’émancipation de femmes-victimes qui restaient auparavant silencieuses. Sur ces sujets, nous avons assisté ces derniers mois à des ruptures profondes, d’ordre culturel. La honte qui envahissait les femmes abusées et les réduisait autrefois au silence, s’est reportée désormais sur leurs agresseurs. Les victimes, célèbres ou anonymes, sont à présent appelées des « briseuses de silence » et considérées comme des héroïnes. En l’espèce, elles ont été désignées comme « personnalités de l’année 2017 » par le magazine Time. Autrement dit, ce que les organisations féministes appellent la « culture machiste » semble avoir reculé. Nous pouvons souligner à ce propos que ce renversement s’est accompli également dans des pays comme la France ou l’Espagne, où un certain laxisme envers ces outrages prévalait jusqu’à ce jour.
Il importe surtout d’indiquer que le nombre et la notoriété des victimes ont mené à la constitution d’une parole collective qui s’est largement déployée à l’échelle transnationale. Cette nouvelle donne pourrait imposer cette thématique à l’agenda des gouvernements et faciliter dans le même temps les pressions sur les institutions politiques et les entreprises. Mentionnons en l’occurrence le rôle précurseur en juin 2017 de Susan Fowler qui – grâce à son blog et au récit de son expérience au sein de la firme Uber – a contraint à la démission le dirigeant emblématique de la Silicon Valley, Travis Kalanick.
Ce mouvement en faveur de la cause féminine tient à une organisation spécifique, caractéristique de tous les faits médiatiques d’envergure ; l’échelle transnationale offrant une visibilité cruciale et une capacité d’influence accrue. À l’instar des grandes organisations non-gouvernementales, cette campagne emprunte des formes réticulaires grâce auxquelles il apparaît plus aisé de capter l’attention des opinions publiques. Il s’agit de créer le buzz et de susciter une communication virale, pour reprendre les expressions des communicants. En fait, son ampleur tient davantage à une mobilisation de type individuel, désinstitutionnalisée et en ligne plutôt qu’aux interventions traditionnelles et routinisées des organisations féministes. En outre, son caractère américano-centré est dû avant tout à la prépondérance des acteurs non-étatiques organisés en réseau et non à une prétendue stratégie du gouvernement américain. Comment ne pas voir que les moyens de diffusion utilisés proviennent de ce pays ; les méthodes employées comme le boycott, le naming and shaming et le rôle clé joué par les stars hollywoodiennes se retrouvent dans toute l’histoire récente des États-Unis ?
En somme, l’affaire Weinstein révèle une nouvelle dimension d’un monde transnational dont l’émergence est souvent perçue à juste titre comme une brutalisation sociale (Laroche). Dès lors, peut-on discerner une dimension émancipatrice dans les événements récents qui témoignerait d’un aspect civilisateur de la mondialisation ?
Références
Dryef Zineb, « Et la parole des femmes se libéra », Le Magazine du Monde, (327), 23 déc. 2017, pp. 14-20.
Kantor Jodi et Twohey Megan, « Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades », The New York Times, 5 Oct. 2017.
Laroche Josepha, La Brutalisation du monde, du retrait des États à la décivilisation, 2e éd. revue et augmentée, Paris, L’Harmattan, 2016.
Strange Susan, States and Markets, 2e éd., Londres, Pinter, 1994.


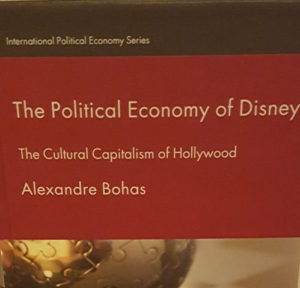 Disney qui connaît une période de succès cinématographiques et financiers sans précédent vient d’acquérir la Fox, une transaction le plus souvent saluée comme l’ultime triomphe de l’entreprise. Cependant, cette acquisition revêt un caractère défensif qui révèle la crise dans laquelle se trouvent les majors hollywoodiennes face à l’essor des opérateurs de l’internet.
Disney qui connaît une période de succès cinématographiques et financiers sans précédent vient d’acquérir la Fox, une transaction le plus souvent saluée comme l’ultime triomphe de l’entreprise. Cependant, cette acquisition revêt un caractère défensif qui révèle la crise dans laquelle se trouvent les majors hollywoodiennes face à l’essor des opérateurs de l’internet.




